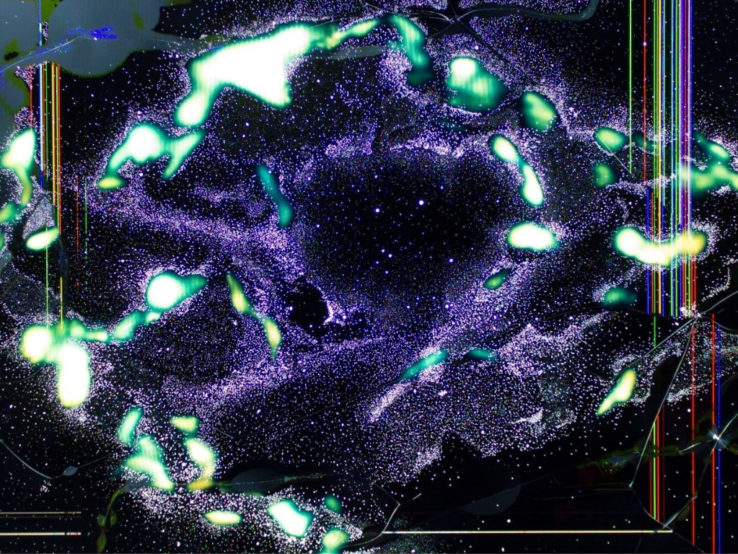Sensible très jeune face à la représentation inégale entre la figure du corps féminin blanc et noir dans les œuvres des musées, Maty Biayenda en prend la pleine mesure lorsque son professeur d’histoire de l’art décrypte L’Olympia d’Edouard Manet, détaillant chaque élément du tableau, les coussins, le chat noir, le rideau, les fleurs… sauf la servante noire au second plan. « Je suis sortie tellement frustrée de ne rien savoir sur cette femme noire ! J’ai immédiatement fait des recherches sur elle, je m’y identifiais. Quelque chose dans son invisibilité me renvoyait à moi-même. » Une perception qui trouvera un puissant écho dans l’exposition « Modèle noir » au musée d’Orsay en 2019, que Maty Biayenda s’est empressée d’aller voir, et pour cause. « Manet montre une femme noire libre », expliquait la commissaire américaine Denise Murrell à l’origine de l’exposition et auteure d’une thèse sur Laure, le modèle de la fameuse servante noire de L’Olympia. Avec sa série photographique Décoloniser Olympia, Maty Biayenda fait poser des femmes de couleur noire à la place du personnage féminin blanc de premier plan dans des reconstitutions du tableau de Manet, le tout retravaillé aux pastels à l’huile intégrant des motifs africains. L’utilisation de plusieurs médiums, la photographie ici mêlée à la peinture, est une référence assumée de Maty Biayenda à l’artiste afro-américaine Carrie Mae Weems, l’une des créatrices qui l’inspirent particulièrement avec l’artiste conceptuel Adrian Piper. Comme ces deux artistes avant elle, Maty Biayenda investit ce vaste champ d’exploration qu’est la construction de l’identité à travers une pratique transdisciplinaire où tous les arts sont égaux et s’enrichissent mutuellement.
Photographie, peinture, dessin, mais aussi collage, design textile, performance et installation sont autant de facettes qui composent l’univers de la jeune créatrice, sans hiérarchisation. Sa première exposition solo Anachronie lors de la biennale de Dakar en 2018, en est le parfait exemple. Les poésies de son amie Amandine Nana, fondatrice de la Galerie Transplantation, dialoguent avec les tableaux, L’Union ,et deux Sans Titre de Maty Biayenda, ainsi qu’avec une installation textile, L’Origine, faite de coquillages brodés et deux vidéos Transmission et Sans Titre. « J’étais partie naïvement sans anticiper la dimension propre au contexte du marché de l’art. J’ai vendu plusieurs tableaux mais j’avais un rapport affectif à certains dessins que j’ai refusé de vendre, j’étais jeune ! », glisse-t-elle amusée. A cette occasion, plusieurs commissaires d’exposition la repèrent, tout comme le créateur de mode Kenneth Ize qui l’invitera à peindre une fresque en temps réel lors de son défilé au Palais de Tokyo à l’automne 2020. Le monde de la mode l’attire autant qu’il l’effraie. « J’avais eu des échos d’un milieu superficiel, j’étais très réservée et ça me faisait peur. » Pourtant, Maty Biayenda se spécialise en design textile au sein de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs qu’elle a intégré en 2017. Elle se forme aux techniques de la maille, du tissage, des raccords de motif, et développe une sensibilité aux matières et à la fibre textile. Le design textile a tout pour la séduire, reliant son goût avéré pour la mode au travail plastique de composition du motif, auquel elle se consacre de plus en plus. Une commande de l’agence de photographie Modds lui permet de créer un motif décliné sur les tote bags et cartes postales des Rencontres de la photographie d’Arles en 2018. On y voit deux femmes noires en costumes éclatants faisant crépiter les flashs sur un fond rappelant les papiers découpés d’Henri Matisse dont Maty Biayenda a déjà repris La Danse, représentant une ronde de femmes noires.