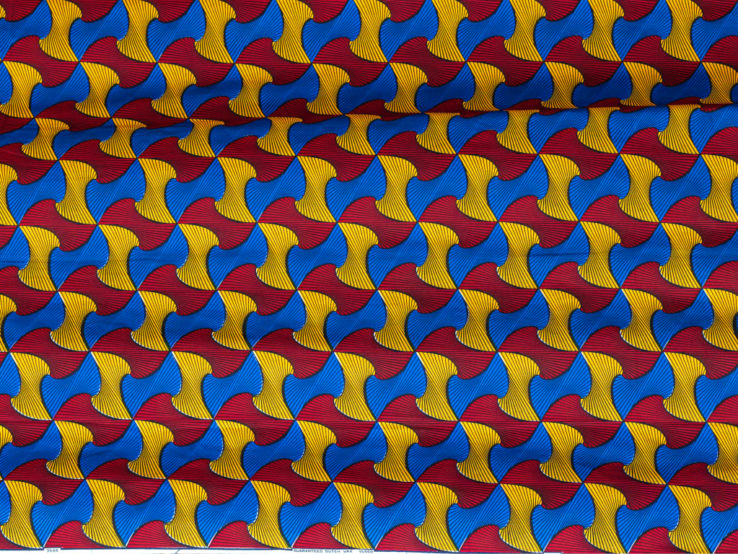Une des phrases les plus importantes de cette méthode est simple, mais essentielle pour lui : “Un poète mort n’écrit plus. D’où l’importance de rester vivant”. C’est cette pensée, profondément ancrée chez Michel Houellebecq, qui l’a empêché, explique-t-il, de se suicider. C’est en cela que le voyage, qu’il soit réel ou intérieur, est une des conditions sine qua non de la survie de son auteur. Le mystère de la vie et de la création tient en cette croyance. Mais au-delà de celle-ci, quel est finalement le but de cette quête sans fin ? De cette aventure littéraire et artistique ? “J’ai une mission. Je ne sais pas vraiment comment l’expliquer, mais j’ai une mission et je dois l’accomplir. Voilà pourquoi je continue, et que je continuerai aussi longtemps que possible.” Rester Vivant – Méthode, le film, avec Michel Houellebecq et Iggy Pop, disponible en DVD. Michel Houellebecq est toujours à l’affiche de Thalasso, réalisé par Guillaume Nicloux, aux côtés de Gérard Depardieu.On le décrit souvent comme un ermite, reculé du monde pour mieux le comprendre, le décrire, l’analyser. Et pourtant, s’il y a une chose dont Michel Houellebecq ne se sépare jamais, c’est son sac à dos. Qu’il s’agisse d’aller au café d’en bas ou jusqu’en Thaïlande, en Irlande ou ailleurs, la silhouette est la même : celle du marcheur, archétype du routard popularisé par les guides du même nom, ou d’un baroudeur un peu spécial. On retrouve cette idée de voyage tournant parfois à l’errance, aussi bien dans ses romans et autres textes que dans ses photos. Parcourant le monde, il nous éclaire ici sur sa façon de voyager et de capturer moments, lieux et sensations. Aventurier du quotidien Il est souvent difficile de dissocier l’écrivain et son œuvre. C’est encore plus le cas chez Michel Houellebecq qui a toujours aimé semer le doute, prénommant parfois ses personnages comme lui et se présentant comme le prototype de l’homme blanc occidental moyen. Un point surtout est quasiment commun à tous les personnages houellebecquiens et à leur auteur, c’est la thématique du voyage, de la “bifurcation” comme aime à le dire Houellebecq lui-même. Cette bifurcation, cette envie de partir, de prendre la route pour des destinations plus ou moins définies, fait partie des fondamentaux de l’univers houellebecquien.
Dans son œuvre aussi bien que dans sa propre vie, il faut se déplacer, partir, chercher ailleurs pour trouver un sens à l’existence, ou, dans tous les cas, tenter de trouver du sens. Ainsi l’apparence, le style vestimentaire de Michel Houellebecq, qui a maintes fois été discuté, disséqué, est en fait celui d’un voyageur, d’un touriste bien équipé voire d’un aventurier du quotidien, d’un véritable baroudeur (“barouder : voyager à la découverte du monde, vivre plusieurs expériences sociales, de travail…”, dixit Wikipedia). Tout d’abord, la parka, à l’origine une Marlboro Classics (chargée de tout l’univers d’aventure développé par la marque à l’époque : cow-boy et grands espaces), que Michel Houellebecq affectionne “pour une raison simple : c’est le nombre de poches et d’endroits pour ranger des choses. Peu de parkas sont aussi bien faites. Mais aujourd’hui, il est très difficile de trouver encore des modèles Marlboro Classics. Je le déplore…” Il y a ensuite les chaussures, sans grandes qualités esthétiques mais très fonctionnelles, et surtout le sac à dos, symbole de celui qui part à l’aventure. Une réminiscence également des années d’école, des études. Le fait de porter quasiment en permanence ce sac à dos signifie beaucoup de choses. Tout d’abord, la curiosité face au monde. Le fait de pouvoir transporter avec soi des instruments et outils qui serviront à prélever des informations, que ce soit un dépliant touristique, un livre, une carte quelconque. Il s’agit aussi d’avoir en permanence sous la main carnets, stylos, appareils photo et autres accessoires pour capturer ce qui se passe alentour. Il y a bien là une esthétique du sac à dos, qui est une façon d’envisager son rapport au réel, au monde. Une idée de collecter, d’enregistrer les lieux, les êtres, les mots, les détails qui font et organisent la topologie des espaces qui nous entourent, que ce soit une gare, un appartement ou bien les rayonnages d’un supermarché. Chez Michel Houellebecq, l’aventure commence dès le seuil de la porte. Elle démarre même souvent avant…