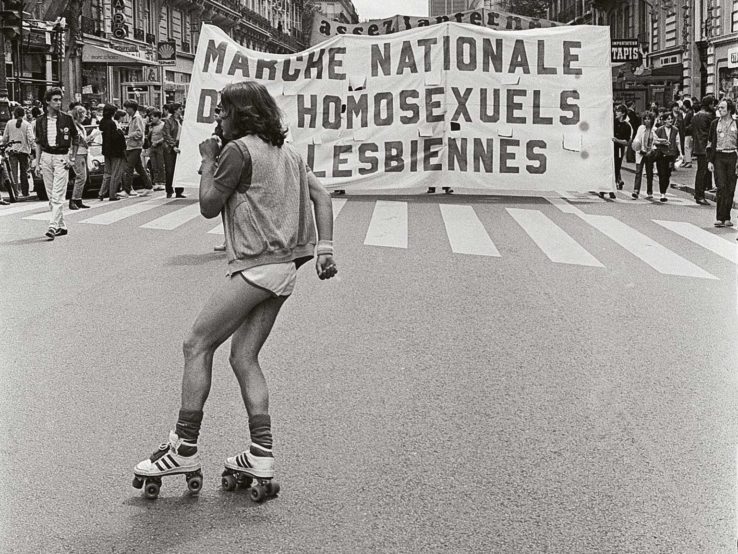Sèta est maintenant assise, le casque vissé sur les oreilles. Ses mains ne tremblent pas, mais son cœur se déploie en fanfare dans les écouteurs et dans ses omoplates collées au dossier de la chaise. Il ne reste plus qu’à appuyer sur play. Elle attend encore un peu. Respire par le ventre. Rouvre les yeux pour regarder, à travers la fenêtre qui donne sur l’atrium, la foule faire semblant de déambuler au gré des rencontres pour se masser invariablement autour des buffets. L’air commence à sentir le champagne et la chaussure, alourdi encore par les rires forcés et les exclamations casinos de Las Vegas des invités. Bon, se dit Sèta, c’est pas vraiment comme ça que je m’imaginais le plus grand moment de ma vie, mais asta e. Elle est presque prête. Une tension dans le trapèze gauche lui rappelle qu’elle a laissé tous les appels et texto de sa mère en suspens et que ce n’est pas bien. Deux jours que sa mère s’inquiétait, sentait qu’il se tramait quelque chose, que Sèta ne disait rien, ce qui n’était jamais bon signe. Mais qu’est-ce qu’elle pouvait bien lui répondre pour qu’elle arrête de se tordre les mains en se lamentant en roumain, ce qui avait à chaque fois le don d’agacer Sèta et de lui briser le cœur en même temps ? Qu’elle avait soudoyé, rusé, manigancé, probablement mis un paquet de gens dans la merde pour obtenir des enregistrements interdits au public ? Que oui, c’était encore une histoire de baleine ? Que non, elle n’avait pas envie de passer à autre chose ? Futu-i, fuck, putain, c’était pas le moment de se laisser emporter dans une de ces querelles imaginaires qu’elle ne gagnait jamais. Inspire, expire. Sèta pose à nouveau les yeux sur le lecteur. Et sentant qu’au fond il n’y a jamais de timing parfait pour sauter de la falaise, elle appuie sur play.
Les premières secondes déroulent le bruit de la mer. Pas celui du rivage, celui de la mer. Sèta n’a jamais nagé dans l’océan, jamais mis la tête sous l’eau pour la ressortir hilare au milieu des vagues et se rassurer vite fait sur l’existence d’une vie à la surface. Rien que l’ampleur du caisson marin lui fait monter les larmes aux yeux. Elle entend maintenant comme des bulles qui hésiteraient à éclater, des surfaces qui semblent glisser les unes sur les autres, des explosions assourdies par la neige. Elle ne comprend rien, et c’est la sensation la plus délicieuse possible. Et puis, les premiers chants. Quelque chose entre le babil d’un enfant et le mugissement d’une vache, qui lui tord instantanément le bide. Ou non, plutôt comme un essaim d’abeilles et des pales d’hélicoptères. Un chaton, un dragon, les pleurs d’une femme inconsolable dans la forêt, l’écho d’une cour d’école à la récréation. Elle rit toute seule de cette conversation confuse qui se met en place entre ses oreilles. Blanche Neige, elle pense à Blanche Neige entourée par les oiseaux et les animaux de la forêt, joyeuse, confiante. Elle se sent en sécurité, comme jamais elle ne l’a été auparavant. Et puis, c’est la panique. Les chants suivants lui racontent en 23 Hz toute l’horreur du monde. Les ambitions mal placées, les mesquineries inutiles, les compromis fades et les violences sans enjeu. Et pendant une microseconde elle comprend pourquoi, quoi qu’on fasse, le monde restera ce qu’il est, ne progressera jamais vraiment malgré les changements de vocabulaire, et pourquoi c’est une vaste plaisanterie de penser que l’être humain est ce qu’il y a de mieux en matière d’espèce. Elle oublie maintenant. Ne reste qu’un vague arrière-goût, un truc qu’elle a sur la langue et qui, elle l’espère, va finir par revenir. À nouveau elle pleure. À cause de la beauté. Qu’elle entrevoit partout, sous ses formes les plus furtives, dans tous ses recoins inespérés. Les chants l’appellent, mais elle ne sait pas comment répondre. Son corps trépigne, mais pour aller où et faire quoi d’autre qu’imploser sous son propre élan ? Quand elle était adolescente, et qu’elle jouait avec ses amis à “Et si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel ? ”, elle ne pouvait s’empêcher de mépriser un peu ceux et celles qui voulaient devenir invisibles ou voler, alors que clairement le seul pouvoir qui valait le coup c’était d’entrer en combustion spontanée sous l’effet de sa propre colère. C’est à ça qu’elle pense alors qu’elle se consume de l’intérieur. Le feu, elle a enfin le feu, et ses mains pourraient créer des boules immenses qu’elle enverrait aux quatre coins de la planète. Un léger cliquetis, suivi d’un grand clac. La première bande s’arrête. Au loin lui parviennent les bruits des verres qui s’entrechoquent et le brouhaha des conversations convenues.
Les enceintes sont déjà branchées. Sèta n’a qu’à les déplacer sur les tables près des fenêtres. Elle cale en dessous les flyers bleu océan d’avant, qu’elle ne distribuera pas, pour les incliner du mieux qu’elle peut vers l’atrium. C’est un peu du bricolage, mais ça lui semble assez solide pour durer le temps nécessaire. Elle pousse le son au max. Cette fois-ci, elle n’a pas besoin de respirer par le ventre avant d’appuyer sur play.
Le chant des baleines envahit tout l’espace : celui de son corps, de la régie, du ciel au-dessus de l’atrium, qui se fige la main dans les petits fours. La foule commence à palpiter en rythme, à traverser à l’unisson l’émerveillement et la terreur, à se resserrer un peu plus sous les assauts du chagrin et de la joie. Séta regarde où en est la bande. Il reste moins de trois minutes. Elle enlève ses chaussures. Grimpe sur l’un des bureaux. La foule se meut en vagues amples au gré de ses propres ressacs. En enjambant la fenêtre, Sèta fait vaciller une enceinte. Les flyers s’éparpillent dans l’air, laissant s’échapper un banc de baleines, dessinées naïvement au feutre. Alors qu’elle bascule en souriant, Sèta n’a le temps que d’un regret : elle aurait quand même dû rappeler sa mère.