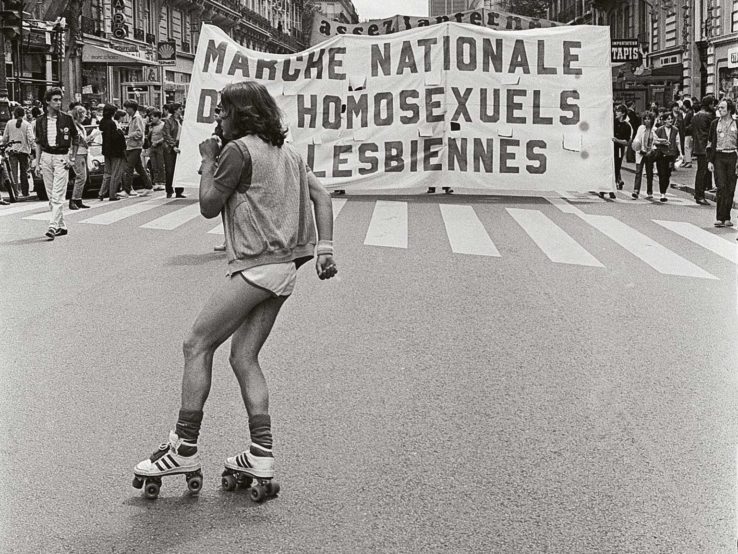“Le monde entier est un théâtre”, clamait Shakespeare. Et la mode d’Arturo Obegero l’illustre parfaitement. Ce designer de 27 ans vient de Tapia de Casariego, un petit village de pêcheurs dans la région des Asturies en Espagne. De là, il regardait son père et son frère surfer, pendant qu’il préférait se laisser flotter ou dessiner des animaux marins. “J’ai grandi dans cette sorte de péninsule, avec d’un côté la mer à perte de vue et de l’autre un paysage montagneux vertigineux. Ce bout de paradis romantique m’inspire énormément, surtout dans ses aspects les plus mystiques”, nous raconte-t-il depuis son appartement qui lui sert également d’atelier à Montreuil, en juin 2021.
Mixer le tailleur et l’univers du surf
Lui qui rêvait de devenir le commandant Cousteau se passionne également pour la danse et la musique dès l’enfance. Mais ses premiers souvenirs mode, c’est sûrement lorsqu’il devait se mettre sur son 31 pour les réunions familiales à Oviedo, la capitale des Asturies : “Là-bas, c’était beaucoup plus conservateur et guindé que mon village natal. Ça me fascinait qu’on passe de nos combinaisons de surf en néoprène à chemise et chaussures cirées pour aller au restaurant de la grande ville. J’avais presque l’impression d’entrer dans la peau d’un personnage. C’est comme ça que j’ai compris à quel point les vêtements peuvent changer la perception qu’ont les autres de toi, ainsi que celle qu’on peut avoir de soi-même. Soudain, on va peut-être se tenir plus droit, plus digne, se sentir plus confiant.” Ce qui lui a servi de déclic à l’envie de devenir designer, c’est le premier défilé d’Alexander McQueen, Plato’s Atlantis, retransmis en direct sur Internet en octobre 2009 : “Je m’intéressais déjà à la mode, mais je n’ambitionnais pas forcément d’en faire mon métier, jusqu’à cette fameuse présentation, révolutionnaire à l’époque ! Je me vois encore demander à ma mère de n’appeler personne (puisqu’à cette période téléphone et internet étaient sur la même ligne), pour que je puisse y assister dans mon coin !”
“Central Saint Martins a débridé ma créativité”
Sa résolution prise, il part à 17 ans étudier les bases techniques à la Escuela Superior de Diseño y Moda Goymar, à La Corogne, un peu plus à l’Ouest d’Oviedo. C’est d’ailleurs là où siège le groupe Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear, etc.). “Moi qui ne rêvais que de McQueen et de Balenciaga, dans cette école, j’ai pu vraiment apprendre à coudre, couper, patronner et utiliser des programmes de modélisme sur ordinateur, tout en aspirant à rejoindre, plus tard, la prestigieuse Central Saint Martins à Londres. Soutenu par ma mère, j’avais une enveloppe où je mettais toutes mes économies pour ce projet. Au bout de trois ans à La Corogne, j’ai fait un stage chez Marcos Luengo, une maison espagnole où j’ai pu toucher à tout : prêt-à-porter, robe de mariée sur mesure, chaussures, sacs… À la fin, on me faisait tellement confiance qu’on m’a confié les rênes d’un défilé. Je me souviendrai toujours qu’on avait cinq paires de chaussures pour 20 mannequins censées effectuer en tout 50 passages. Ça s’est étonnamment bien passé (rires) !” Puis Arturo parvient à rejoindre Central Saint Martins, où il étudie durant trois ans : “Le style de cette université, ses méthodes d’enseignement et les élèves présents étaient très différents de tout ce que j’avais connu jusque-là. Ça a été un choc assez brutal pour moi, mais très bénéfique, car ça m’a permis d’enrichir ma vision, de nourrir mon regard d’autres horizons et de mieux cerner qui je suis et ce que je veux faire. J’y suis allé avec mon expérience très technique qui me permettait de donner corps à mes idées les plus folles. CSM a débridé ma créativité.”
Les illusions perdues à Paris
Paradoxalement, c’est sans doute ce passage à la capitale anglaise qui lui a permis de comprendre que sa place créative se situait plutôt du côté de la Ville Lumière : “Londres est un shaker de créativités, où l’on peut être libre de s’exprimer et d’explorer sans jugement. Paris peut sembler plus conservateur en comparaison, mais l’amusement se trouve ailleurs, notamment dans la façon de jouer avec les codes de la séduction et du sexy”. Juste après Central Saint Martins, Arturo Obegero postule donc à Paris auprès de différentes maisons. Il entre chez Lanvin, à cette période si compliquée où Alber Elbaz, directeur artistique adoré de 2001 à 2015, vient d’être viré sans ménagement, à la stupeur générale. S’en suivent quelques années d’errance pour la plus ancienne maison de couture encore en activité où se succèdent les têtes (dont Bouchra Jarrar et Olivier Lapidus) et les incompréhensions. Jusqu’à l’arrivée de Bruno Sialelli en janvier 2019. Arturo Obegero aura à peine le temps de le croiser, puisqu’il occupe un poste de Junior Designer des collections femme de mai 2018 à février 2019, avant de se résoudre à créer sa propre marque et de la lancer quelques mois plus tard. Entrer dans une maison existante afin d’y gravir les échelons, étape par étape, et peut-être un jour en devenir le directeur artistique ? Mission quasi impossible tant il y a de candidats, si peu d’appelés et encore moins d’élus, comme le comprend alors amèrement le jeune créateur.