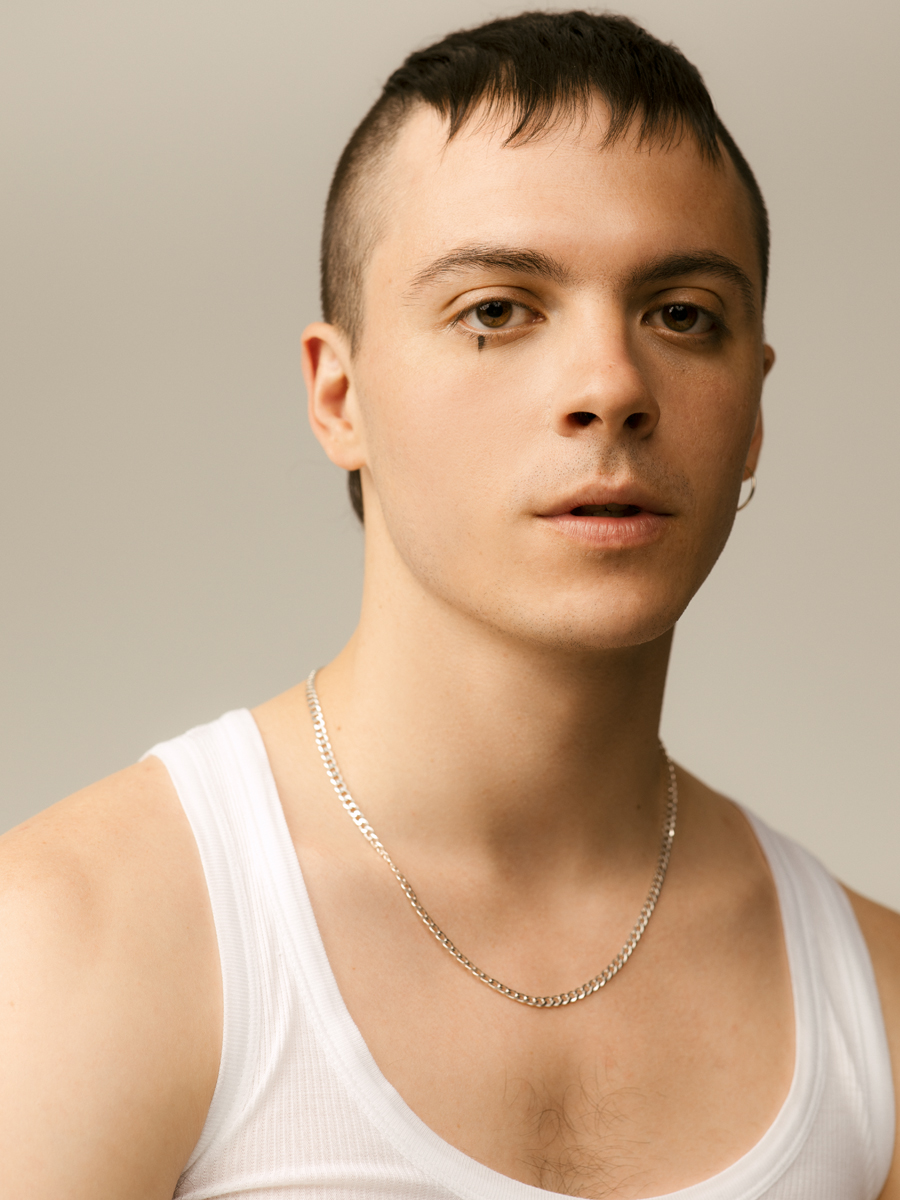Mixte. Vous étiez cet été à l’affiche des festivals Cabourg mon amour, Fnac Live, Pete the Monkey… Quel est votre rapport au live ?
Nelson Beer. Sur scène, j’ai besoin de performer. J’ai des pompes à plateformes de 15 cm, je me maquille. Je n’ai jamais étudié la danse, mais à la maison j’ai un espace qui lui est dédié. Pieds nus et en slip, je m’imagine face à un public. Si je n’ai pas envie de me lever de ma chaise et de danser quand je fais de la musique, c’est que ce n’est pas un bon morceau. L’idée est de changer de live à chaque concert. C’est important pour moi de me remettre en question. Rien ne doit être figé. Je ne veux pas être un produit brandé.
M. Vous avez pratiqué le skateboard de façon intensive entre 12 et 21 ans avant de vous blesser. Skate et scène, même combat ?
N. B. J’ai toujours utilisé mon corps comme un outil d’expression. J’ai envie que le live soit aussi intense que lorsque je faisais du skate. L’idée de tout donner avec une certaine virulence me plaît bien. J’adore la douleur, la violence. J’aime bien sortir d’un live lessivé.
M. Vos clips mettent en avant beaucoup de sensualité, d’érotisme, voire de sexualité. Que cherchez-vous à transmettre par cette surexposition du corps ?
N. B. J’essaie de rendre mon corps le plus public possible. C’est très déshumanisant de s’exposer autant. C’est presque de l’ordre de l’autodestruction car je suis quelqu’un d’assez timide. Comme écrire des chansons, c’est une mise à nu. Ça soutient l’idée qu’il y a un pouvoir exercé sur le corps. C’est le concept de la bio politique : chaque corps dans la société est régi en fonction de son origine, de sa sexualité. J’ai envie de donner le mien un peu comme on donne son corps à la science. Mon corps d’homme blanc privilégié. C’est assez thérapeutique et en même temps une prise de risque. Ça permet d’expulser des choses de soi.
M. Vous citez régulièrement Charles Bukowski. En quoi son œuvre littéraire résonne-t-elle dans votre travail ?
N. B. Bukowski, c’était au tout début. J’avais un groupe de rock à 15 ans en Suisse, Les Bukowski. On aimait sa poésie et le personnage assez cynique. Mais surtout, il me faisait beaucoup rire. Un peu comme Louis C.K. ou Blanche Gardin aujourd’hui, qui sont des personnes très crues, qui n’ont pas de filtre, qui disent la vérité. J’essaie d’aller puiser dans les endroits les plus sombres de moi. Oblique II est un album un peu émo qui exprime une certaine mélancolie du xxie siècle, le fait que je ne ressente rien, comme si j’étais sous sédatif, et qu’on arrêtait de se battre. Mais il y a quand même une petite note d’espoir, une lueur au bout du tunnel.
M. Dans Oblique, l’homme est plus féminin qu’on ne le croit. Pourquoi interroger la notion de genre ?
N. B. Surtout la notion d’identité en général. J’ai envie d’explorer le spectre du genre car c’est quelque chose qu’on ne choisit pas. J’aime beaucoup l’idée d’une identité en changement, qui échappe au contrôle, au pouvoir souverain. Se demander comment on peut intégrer la société de manière plus libre en fonction de comment on est identifié administrativement. Le titre du projet Oblique vient de là : ce n’est pas grave d’être bizarre, d’être un peu de biais…
M. Vous êtes né en Suisse, avez vécu en Californie et étudié à Londres avant de poser vos valises à Pantin. Aujourd’hui, de quelle culture vous sentez-vous le plus proche ?
N. B. Je me sens toujours proche de la culture dans laquelle je suis. Quand j’étudiais l’architecture à Londres, j’étais très sensible à la culture anglaise, à la question des lois d’immigration. Maintenant que je suis en France, c’est la politique française qui m’intéresse. Dès l’instant où on devient public, où l’on crée quelque chose, où on participe à la culture, ça implique forcément le politique.