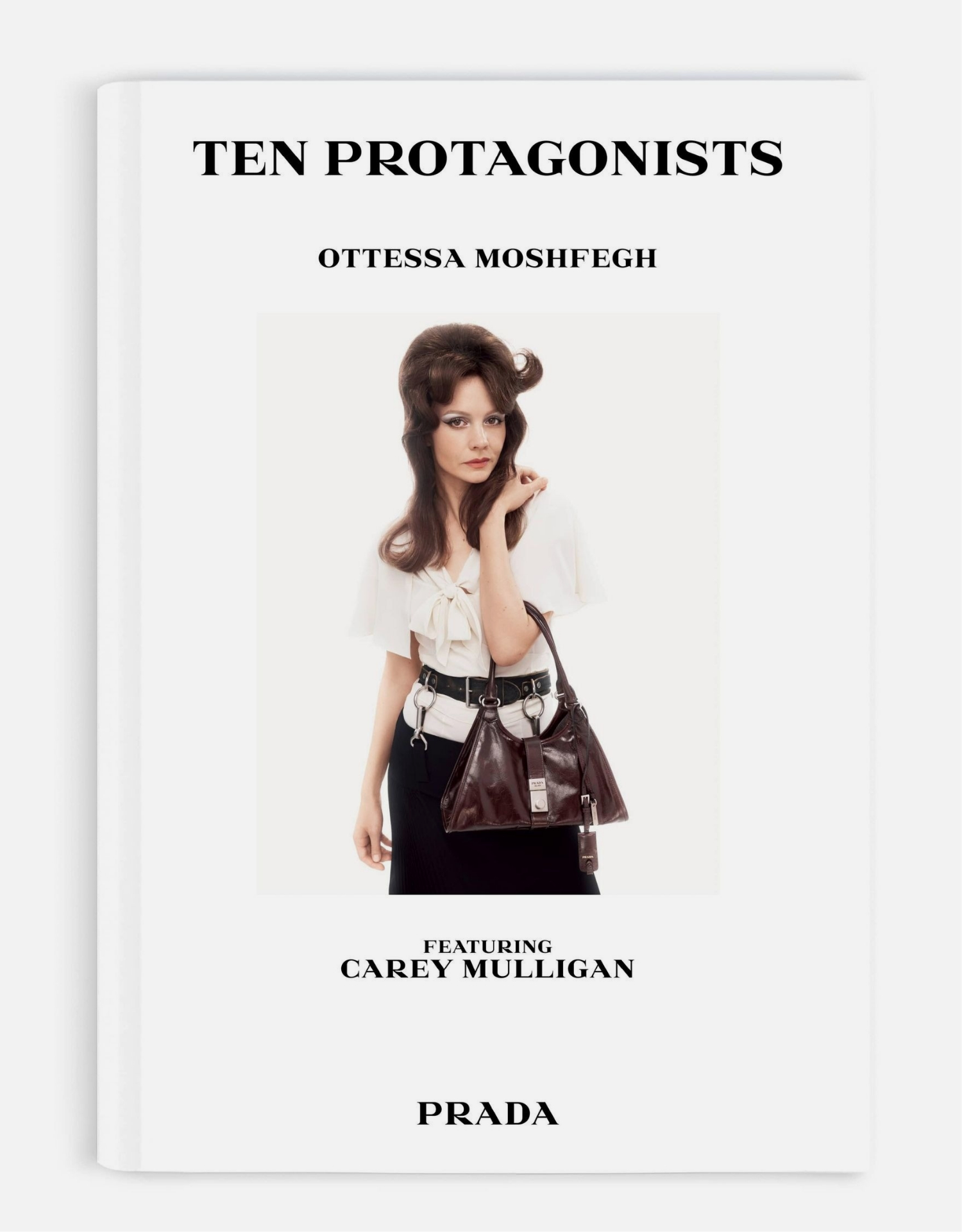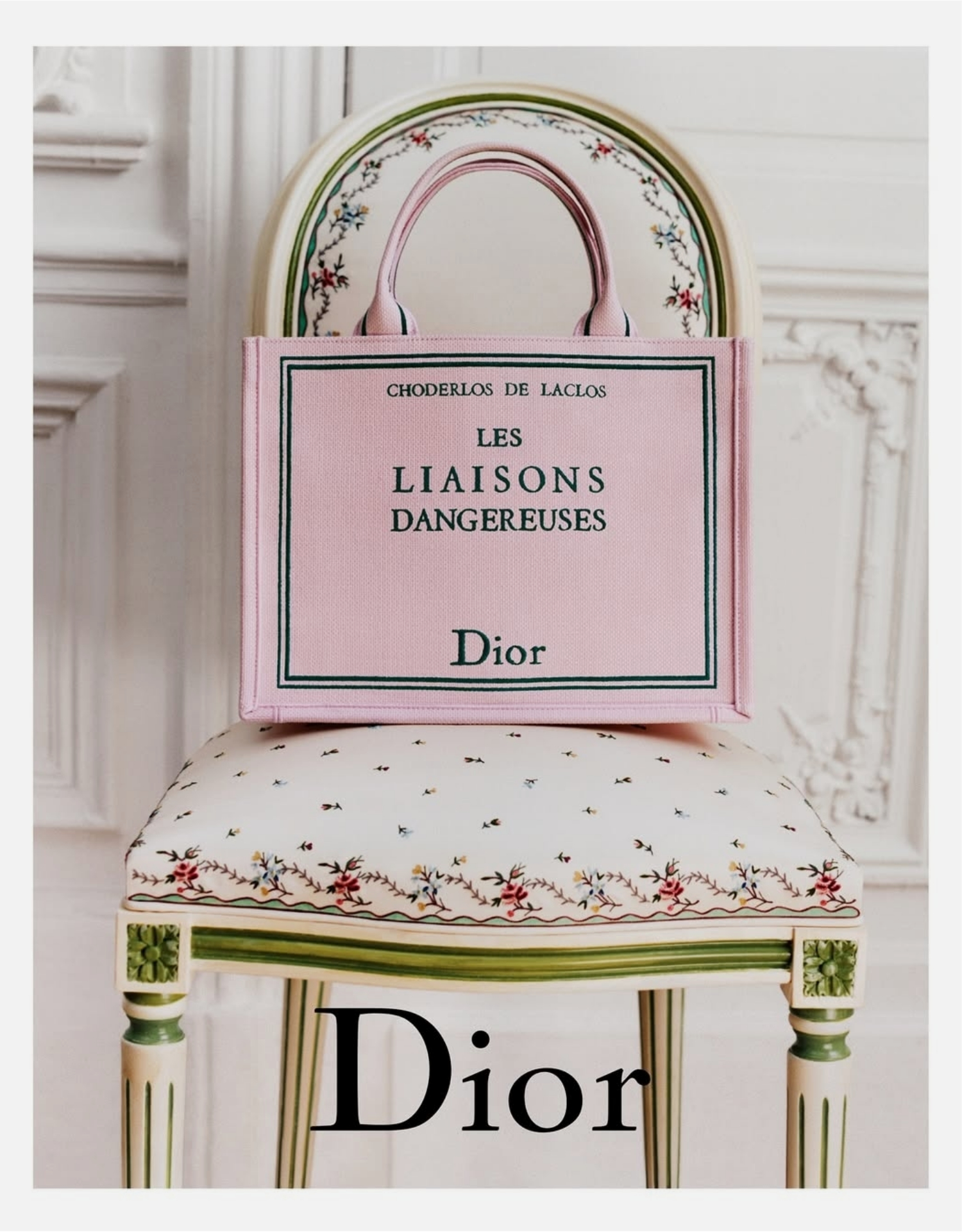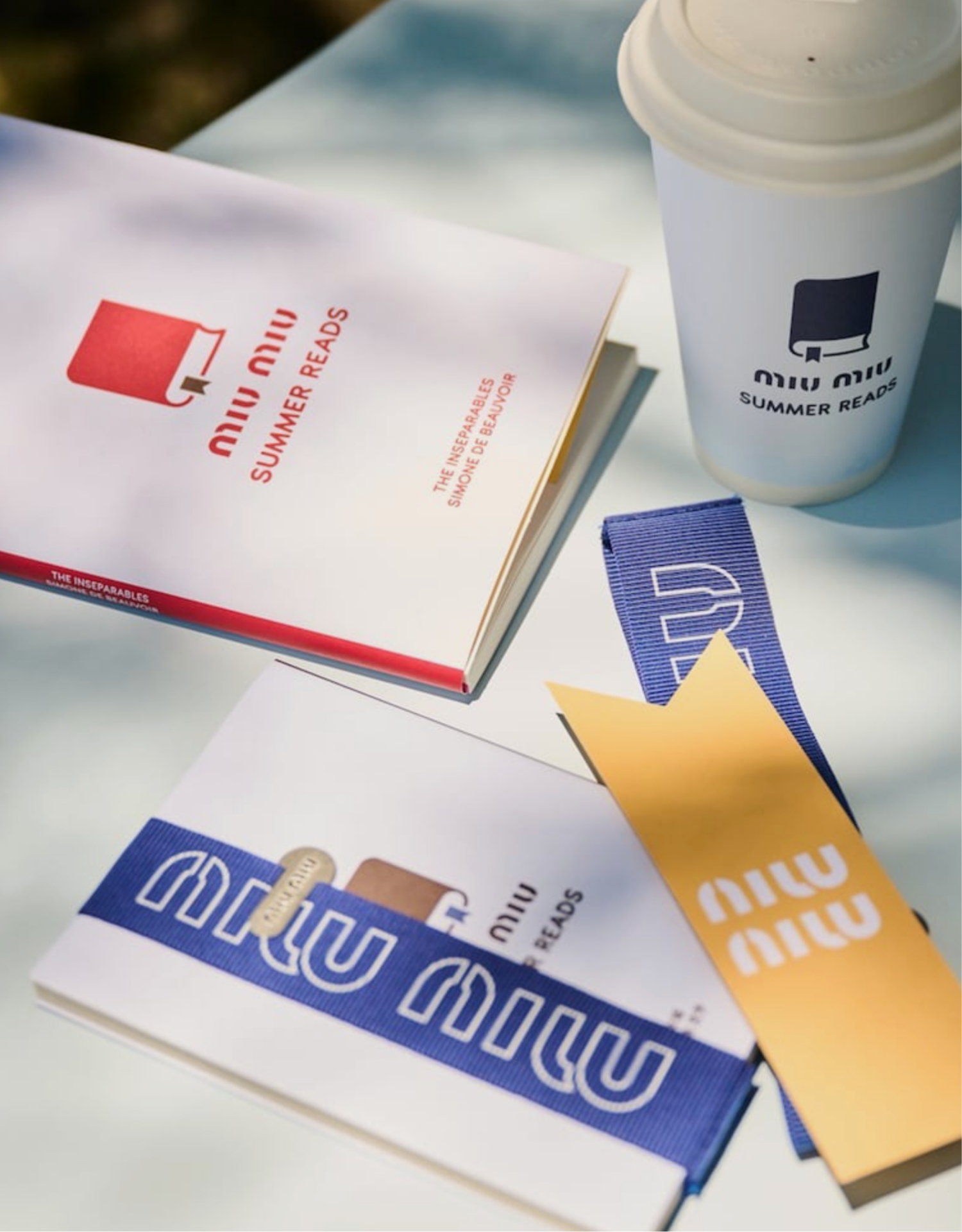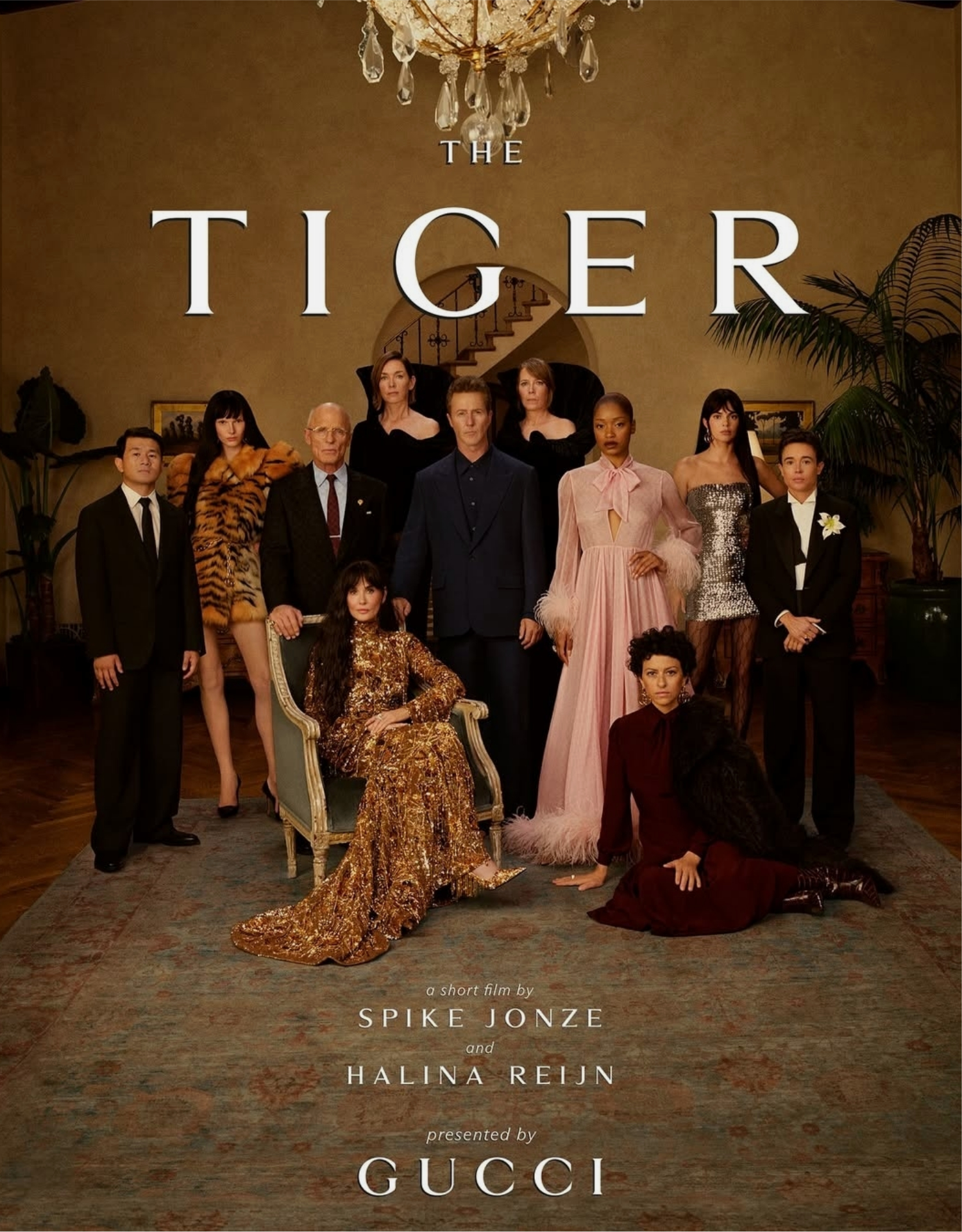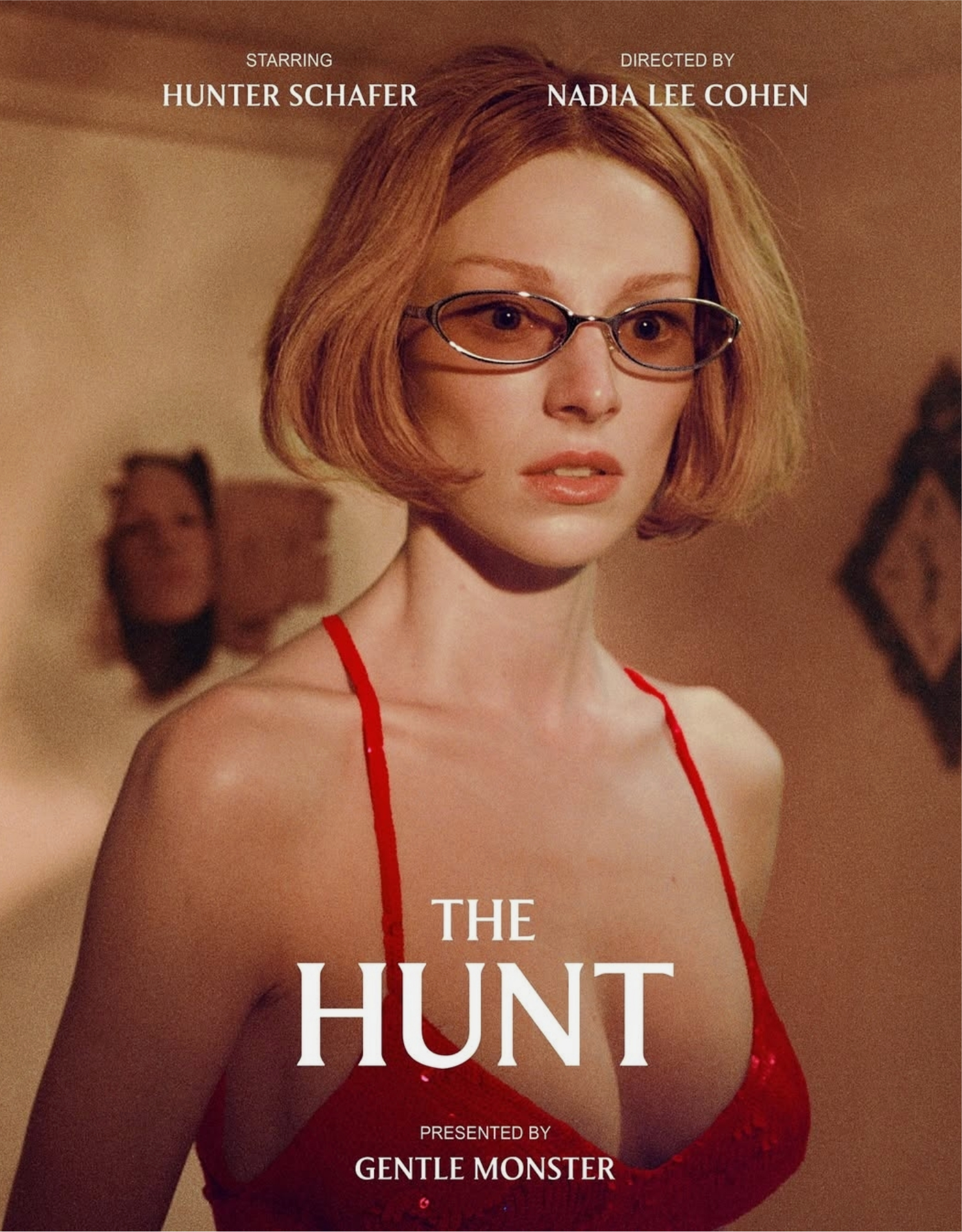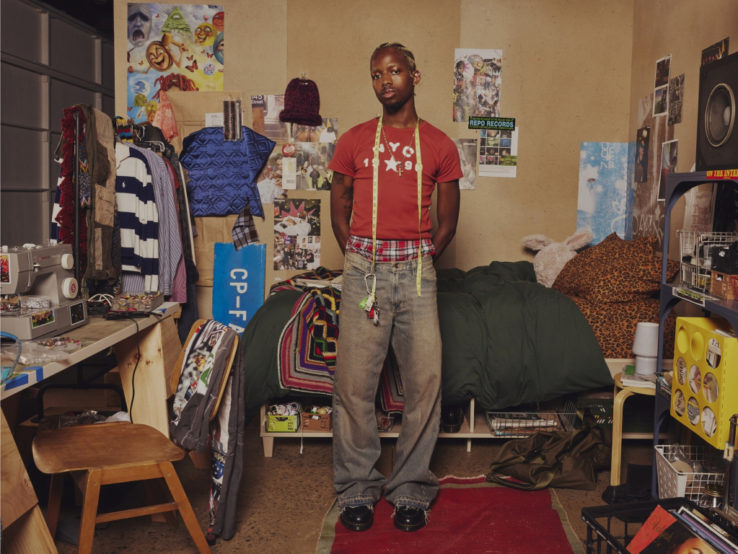Pour preuve encore, la jeune marque espagnole Paloma Wool qui pour l’automne-hiver 2025 a fait défiler, au sein de la bibliothèque du Lycée Henri IV, ses mannequins dont l’une lisait à voix haute un ouvrage qu’elle tenait entre ses mains lors de son passage sur le catwalk. Une mise en scène littéraire rappelant aussi le premier défilé de la marque Tamme à la fashion week de Tokyo Fall-Winter 2025 où certains mannequins portaient des cahiers et des livres. Et de la littérature au cinéma, il n’y a qu’un pas : Saint Laurent qui lance sa propre filiale de productions, Alexandre Mattiussi d’Ami Paris qui s’essaye à la réalisation, sans oublier les films Women’s Tales de Miu Miu présentés à la Mostra de Venise et les nombreuses autres marques qui développent des partenariats avec des festivals ou des plateformes de streaming… “La mode est un moyen d’expression en soi qui suscite de l’émotion autant que le fait un roman, un film ou une œuvre d’art, ajoute Clara de Pirey. Tout cela participe à concrétiser un engagement avec l’excellence.” Pour autant, il y a un territoire narratif que la mode chérie particulièrement et qu’elle n’est pas près de délaisser : l’affect. Sophie Abriat parle d’un “capital émotionnel” qui, pour exister, s’appuie largement sur les histoires personnelles des créateur·rice·s. C’est le cas du designer turc Hussein Chalayan dont “les collections, largement biographiques, font référence à son histoire personnelle et familiale faite d’exodes et de déracinements, et évoquent des questionnements liés aux religions, à la guerre, aux nouvelles technologies, aux rapports entre l’Occident et l’Orient”, détaille Sophie Abriat dans son ouvrage. De quoi transformer définitivement l’art du storytelling, initialement basé sur le récit personnel, en outil politique.