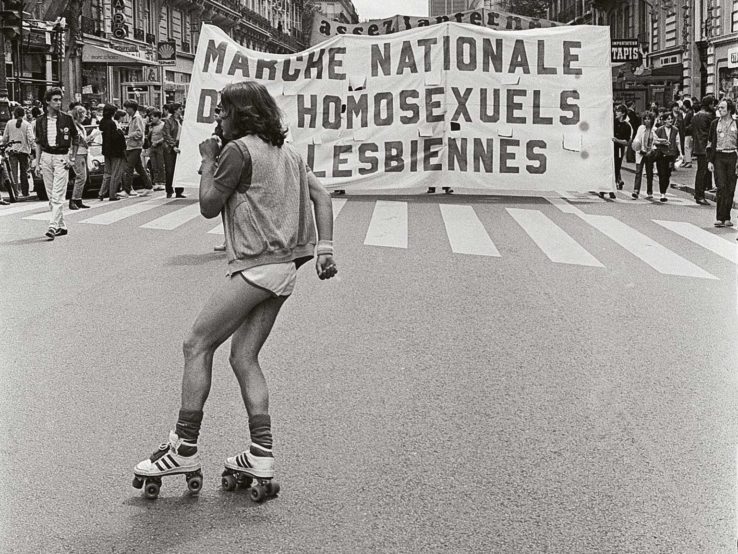Ne l’appelez plus Sliimy. Au cours de son enfance tourmentée du côté de Saint-Étienne, entre le décès prématuré de sa mère, le harcèlement scolaire et les violences éducatives, Yanis Sahraouitrouve refuge dans la chorale de son école, remporte un concours qui lui permet d’enregistrer un premier morceau en 2005 et perce sur Myspace. En 2008, le blogueur Perez Hilton tombe sur sa reprise de “Womanizer” de Britney Spears et la porte jusqu’aux oreilles de la star qui demande à Yanis d’assurer la première partie de son show à Paris en 2009, bientôt suivie par Katy Perry la même année pour la Suisse et l’Angleterre. Pourtant, malgré le succès fulgurant de Paint Your Face, son premier album sorti dans la foulée, Sliimy disparaît peu à peu, hormis quelques démos égrainées jusqu’en 2015. C’est forte de son prénom que l’artiste revient, avec une allure et un son radicalement différents pour son nouveau single, “Hypnotized”, annonçant la sortie de son EP autoproduit L’Heure bleue en 2016. Si sa voix de falsetto, trop souvent comparée à celle de Mika et de Prince, est restée la même, Yanis finit par faire son coming trans et non-binaire en septembre 2021. Sur son propre label baptisé Mauvais Genre, elle dévoile enfin un nouvel EP, Solo, plus autobiographique et engagé que jamais. Rencontre avec cette chanteuse queer avant l’heure.
Mixte. Tu as traversé beaucoup d’étapes dans ton processus d’affirmation, en tant que personne mais aussi en tant qu’artiste. Depuis ton enfance jusqu’au début de ta carrière avec les grandes maisons de disque, penses-tu avoir été empêchée d’être toi-même ?
Yanis. Je me posais déjà beaucoup de questions, enfant, sur mon identité de genre. Je me rappelle même que, vers 12-13 ans, je suis allée chez le médecin. Il m’a vaguement recommandé un suivi psychologique, sans vraiment m’éclairer, ce qui m’a d’autant plus fait croire que je souffrais de déviance. Et puis, je n’avais pas les moyens de voir un psy de toute façon. Un entourage bienveillant et encourageant m’aurait fait économiser l’énergie que j’ai dû dépenser à gérer les peurs des autres, leurs insécurités et leurs violences. Ça m’a empêchée de me concentrer sur la création. Croire que toutes ces difficultés m’ont amenée là où je suis reviendrait à glamouriser la souffrance. J’ai toujours été la même personne, mais des gens n’ont pas voulu le reconnaître et m’ont empêchée de m’épanouir plus tôt, de me révéler. J’ai passé plus de temps à désamorcer des obstacles qu’à vraiment avancer.
M. Tu trouves qu’on glamourise trop le concept de résilience, surtout chez les artistes ?
Y. Clairement. La résilience n’est pas un puits sans fin. Je sais que j’y ai beaucoup puisé, mais c’est parce que je n’ai pas eu le choix, sinon j’aurais préféré ne pas me retrouver dans ce genre de situation, de violences éducatives dans mon enfance, notamment. Je pars du principe qu’on n’a pas à vivre cela pour pouvoir être considérée comme une personne belle et forte, en fait. On ne parle pas assez de la responsabilité des gens auteurs de violences. La résilience, c’est génial, mais il ne faut pas oublier qu’elle procède de traumas. J’ai parfois l’impression d’être comme un volcan : longtemps en sommeil, mais qui peut entrer en éruption de façon inattendue à cause d’éléments déclencheurs. C’est d’ailleurs ce que j’évoque dans “Unsteady”, le titre qui ouvre l’EP.