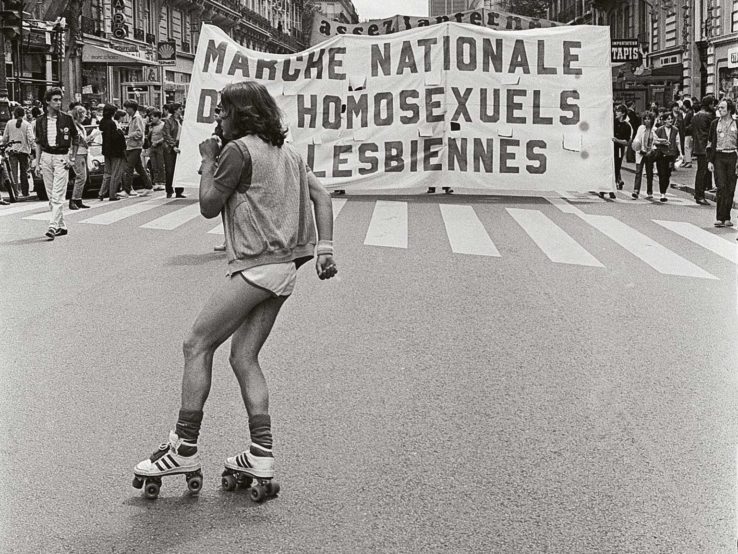Eotopia
Le hameau écolo où rien ne se perd (Cronat, France)
On doit cette communauté située à Cronat, en Saône-et-Loire, au rêve de Benjamin Lesage, 33 ans, qui avait réalisé l’exploit de vivre pendant cinq ans, entre 2010 et 2015, sans avoir recours à l’argent directement (Vivre sans argent, éd. Arthaud, 2016). Après un périple d’un an en auto-stop et en bateau des Pays-Bas au Mexique et plusieurs années d’itinérance en France, c’est en 2016 qu’il concrétise son rêve d’écovillage avec sa compagne Yazmin. Tous deux ont mis la notion d’antigaspillage au cœur de ce projet. Ici, rien ne se perd, tout se récupère. On utilise des toilettes sèches, on s’éclaire grâce à Enercoop, une coopérative qui fournit de l’électricité issue des énergies renouvelables, et on pratique la permaculture. Aucun animal n’est élevé dans cette communauté 100 % végane, qui a décidé de bannir également alcool, tabac et drogues. Pour parer aux besoins du groupe, chaque membre verse 300 euros par an dans un pot commun qui sert à payer impôts, factures et petits extras. À côté de cela, chacun est libre d’avoir un petit job rémunéré, s’il le souhaite. Bref, une consommation réduite au minimum pour une société rêvée où l’argent ne serait plus roi.
Christiania
Une ville libre dans la ville, entre ganja et marxisme (Copenhague, Danemark)
Sans doute l’une des communautés intentionnelles les plus célèbres en Europe, Christiania s’étale sur 34 hectares de nature sauvage et de rues piétonnes, parsemés de bâtiments en brique ornés de graffitis, de maisons en bois, et qui comptent aujourd’hui quelque 1 000 habitants dont 200 enfants. Son épopée commence en 1971, lorsque Copenhague fait face à une pénurie de logements sans précédent. Au cours de l’été, des dizaines de militants anarchistes, hippies, chômeurs ou encore artistes et étudiants contestataires prennent possession d’une ancienne caserne marine située sur la presqu’île de Christianshavn dans le sud-est de Copenhague. Peu à peu, l’enclave rebelle s’est dotée d’un drapeau, trois points jaunes sur fond rouge, et d’un règlement intérieur. Les voitures ont été interdites, tout comme la propriété privée et la spéculation immobilière. La démocratie est absolue, toutes les décisions sont prises à l’unanimité. Tant qu’une seule personne a un avis opposé, on discute. Inutile de préciser que les assemblées s’achèvent souvent au petit matin… Voilà maintenant cinquante ans que cette ville dans la ville résiste aux autorités et attire autant les Danois que les étrangers. “J’y ai trouvé la liberté que je cherchais. Enfin, j’avais de la place pour respirer et être moi-même”, confie Hélène, Française qui s’est installée à Christiania en 1976. Cet esprit libertaire a aussi donné naissance à Pusher street “la rue des dealers” : un marché à ciel ouvert où la marijuana se vend librement. On vous avait promis l’utopie.
Amazon Acres
L’utopie matriarcale (New South Wales, Australie)
Cette communauté de femmes, qui n’avaient rien à envier à leurs ancêtres guerrières du même nom, a tenté de réaliser son utopie féministe entre 1970 et 1980. Également connue sous le nom de The Mountain, la communauté des Amazon Acres a accueilli une centaine de femmes sur un territoire de 400 hectares dans la région de New South Wales en Australie. Nomades, elles vivaient la plupart du temps nues, se déplaçaient à cheval, dormaient à la belle étoile et construisaient parfois elles-mêmes leurs abris. L’utopie des Amazon Acres reposait sur la règle des trois M : No Meat, no Men, no Machines. Une société basée sur la sororité, sans hommes, sans technologie ni consommation. Les décisions étaient prises par consensus sur des sujets tels que l’éducation des jeunes garçons pour les mères qui avaient rejoint la communauté avec des enfants. Le programme scolaire ? Acrobatie, histoire du féminisme, méditations et anatomie du corps féminin. Ici les Amber et autres Jennifer se rebaptisaient Moonshadow, Jaguar ou bien… Composte. Mais les Amazones ne tardèrent pas à s’attirer les foudres des propriétaires des alentours qui voyaient en ces femmes libres de véritables conquérantes piétinant leurs terrains. À moins que ce ne soit leur ego masculin qui ait été piétiné… Elles durent plier “bagage” et remettre leur rêve d’une société matriarcale à plus tard.